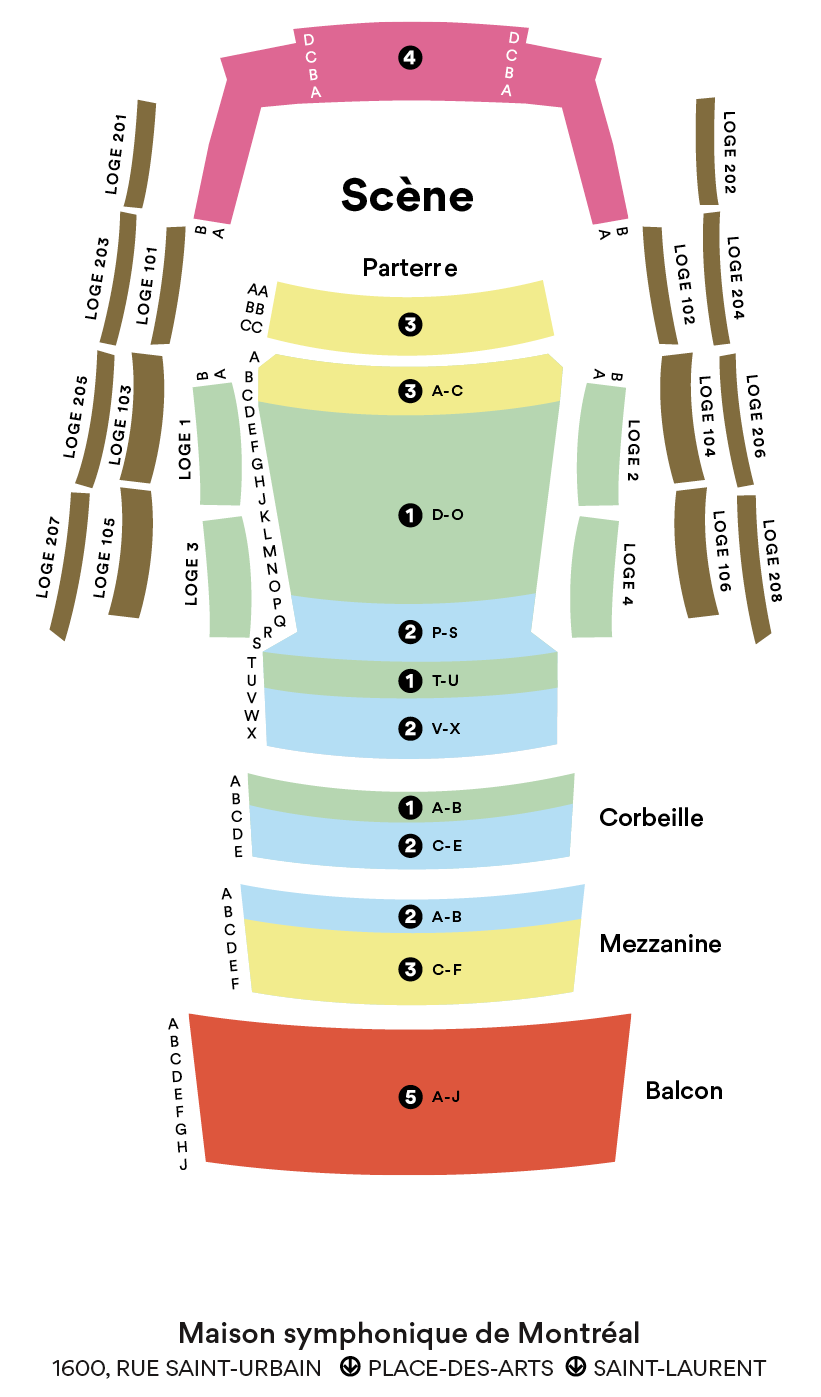Concerto pour piano nᵒ 2
Brahms
1833 – 1897
« Je veux vous informer que je viens d’écrire un petit concerto [Konzerterl] de piano avec un joli petit scherzo [Scherzerl]… » – Johannes Brahms, lettre à Élisabeth von Herzogenberg, juillet 1881
En 1879, vingt-deux ans après son monumental Premier Concerto pour piano, qui ne remporta pas le succès escompté, Johannes Brahms amorce, à peu près en même temps que ses quatre Symphonies, la composition de son Second Concerto en si bémol majeur. Entretemps, il s’était beaucoup consacré à la musique de chambre, au lied et à la musique chorale, a cappella et avec orchestre – le Requiem allemand date de 1868.
Né dans un quartier très pauvre de Hambourg, où son père est contrebassiste dans l’orchestre municipal, le jeune Brahms apprend le piano puis, pendant une dizaine d’années à partir de 1843, il suit l’enseignement d’Eduard Marxsen – c’est à lui qu’il dédiera, trois décennies plus tard, son Second Concerto pour piano. Il se fait les doigts dans les cabarets et les tavernes, avant de rencontrer le violoniste Joseph Joachim, avec qui il s’embarque dans des séries de tournées. Ses premiers essais de composition sont bientôt salués haut et fort par Robert Schumann, qui voit en lui « cet élu, au berceau duquel les grâces et les héros semblent avoir veillé ». Ses débuts sont néanmoins difficiles, avant qu’il fasse de Vienne, en 1862, son port d’attache, lui qui sera toujours en déplacement, et il acquerra peu à peu aisance et renommée.
Brahms conçoit son travail comme un artisan qui peaufine sans cesse son métier : soucieux d’architecture sonore autant que d’expression, il « accomplit, en dehors de tout maniérisme et de tout académisme, cette fusion profonde de l’esprit romantique et de la forme classique », constate Romain Goldron, et, plus encore, « bien peu de musiciens ont eu, au XIXe siècle, une connaissance aussi approfondie de l’écriture contrapuntique ». Très perfectionniste, très critique envers lui-même – il a détruit au cours du temps de nombreuses partitions –, il mettra trois ans à terminer son Second Concerto.
Tous les étés, Brahms se retire à la campagne et « ses plus beaux thèmes sont le fruit de ses longues promenades matinales à travers champs et forêts ». Sa mélodie est généreuse, à la mesure de l’ampleur qu’il confère aux formes, avec un brin de tristesse qui parfois empoigne le cœur. C’est un hypersensible d’un abord peu avenant; s’il cultive de profondes amitiés, il ressentira toujours durement la solitude.
À l’été 1881, à Pressbaum, non loin de Vienne, il termine le Concerto. Un peu auparavant, Hans von Bülow avait pris en main l’orchestre du duché de Saxe-Meiningen, l’amenant à un très haut niveau. En octobre, il invite Brahms à y donner son nouveau Concerto en « lecture » privée, et le duc en est si content qu’il octroie aussitôt au compositeur la croix de commandeur de l’Ordre de la maison de Meiningen! L’œuvre, en quatre mouvements au lieu de trois, montre une incomparable variété thématique et se présente comme un « concerto symphonique » par la complicité parfaite de tous les protagonistes, dans « une léonine combinaison de douceur et de puissance », écrit Calum McDonald.
L’Allegro non troppo initial s’ouvre sur un majestueux appel du cor, qui semble convoquer les autres instruments, le piano d’abord, puis les vents et les cordes. Suit une cadence toute d’arpèges et de jeux de triolets, avant que « le mouvement se développe organiquement en un immense réseau tonal d’idées interconnectées, où le piano ne se contente pas de reprendre les thèmes du tutti orchestral, mais les varie constamment dans un ample dialogue ». L’Allegro appassionato en ré mineur qui suit, que Brahms décrit en blaguant comme un « joli petit scherzo », lui succède, bien moins plaisanterie que tumulte inquiétant d’esprit nordique. Après une section centrale en ré majeur, où « les orages brahmsiens s’éclairent de quelques rayons, la sombre véhémence ne tarde pas à reprendre le dessus », écrit André Lischke. Le mouvement lent, Andante, vient en troisième place, qui, « ondoyé de lyrisme », déroule une bouleversante mélodie au violoncelle, reprise par l’orchestre, mais jamais par le piano, qui se contente de broder tout autour comme en une rêverie. Enfin, un Allegretto grazioso, rondo traité librement, joyeux et fantasque, avec quelques accents tziganes, conclut un des plus grands et plus beaux concertos du répertoire.
© François Filiatrault