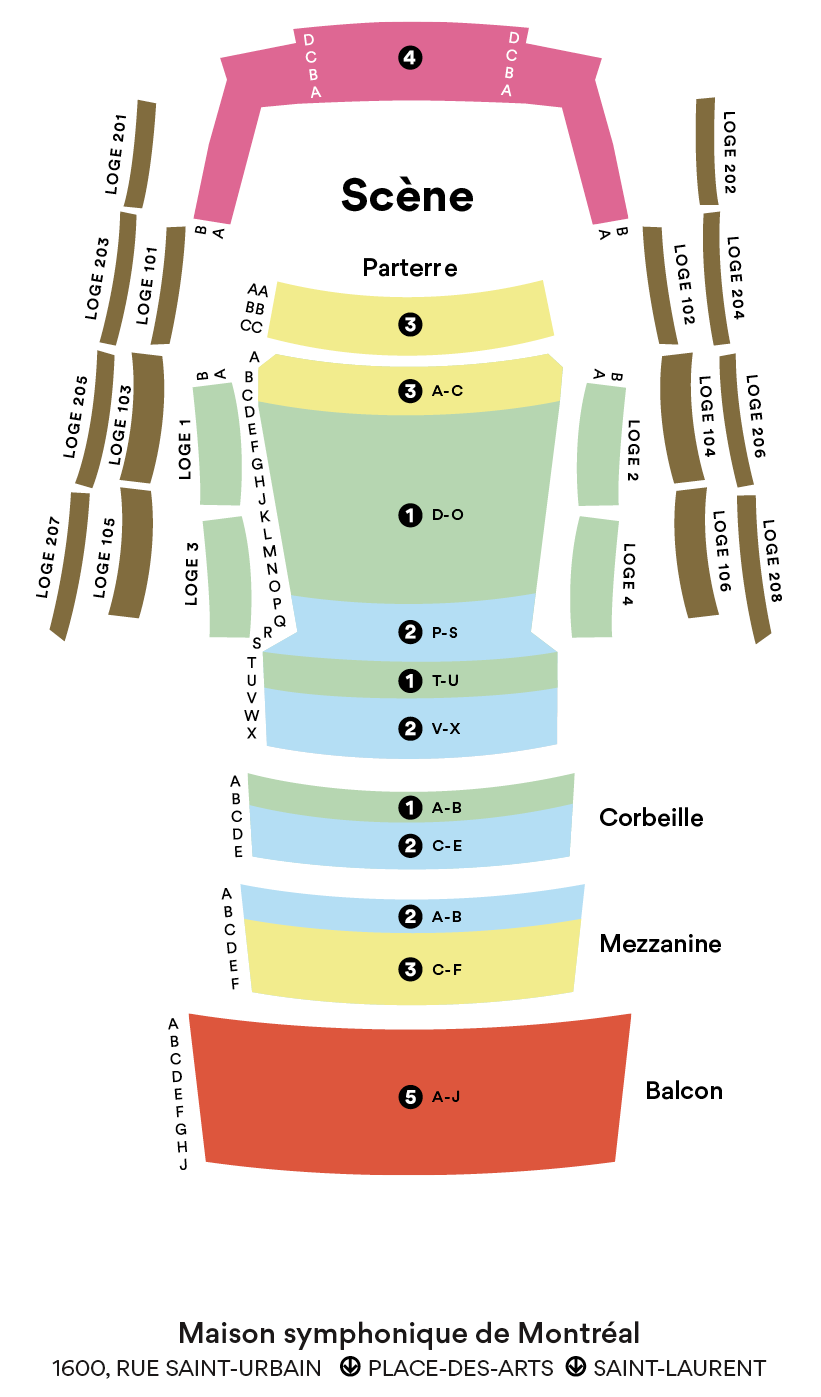D’un matin de printemps
Lili Boulanger
1893 – 1918
Née dans un milieu de musiciens professionnels, Marie Juliette Olga, dite Lili Boulanger, déchiffre les partitions avant même de savoir lire, et c’est un ami de la famille, Gabriel Fauré, qui lui donne ses premières leçons de piano. Atteinte dès l’âge de deux ans d’une grave affection, liée au système immunitaire et qui l’invalidera toute sa vie, elle se familiarise à la maison auprès de divers maîtres tant avec la pratique de plusieurs instruments qu’avec la théorie musicale et l’harmonie, avant de s’inscrire au Conservatoire de Paris en 1909.
En mai 1913 – la maladie l’avait empêchée de concourir l’année précédente –, elle remporte, première femme à y parvenir en musique, le Grand Prix de Rome pour une cantate sur un livret imposé, Faust et Hélène. On loue la « justesse de sa déclamation », sa « sensibilité », son « sentiment poétique » ainsi que son « orchestre intelligent et coloré ». « Décerner ce prix à une femme de dix-neuf ans dans un milieu aussi académique, qui plus est par un jury réputé pour sa misogynie, c’est un signe très fort de reconnaissance », estime Aliette de Laleu. L’œuvre sera donnée en public avec succès et « le mot “génie” surgit enfin dans la presse pour qualifier le talent d’une femme ».
Ce prix s’accompagne d’un séjour de deux ans à la Villa Médicis, à Rome, mais elle n’y travaille que quatre mois, en partie à cause du déclenchement de la Grande Guerre. Elle retourne en Italie en 1916 avec Nadia, sa sœur aînée – qui deviendra la pédagogue la plus marquante du XXe siècle, tout sexe confondu –, mais dès son retour à Paris elle reste le plus souvent alitée. Elle s’éteint en mars 1918 à Mézy-sur-Seine, dans les douleurs d’une tuberculose intestinale, peu avant son vingt-cinquième anniversaire, après avoir dicté à sa sœur sa dernière œuvre, un bouleversant Pie Jesu pour voix soliste et instruments. Profondément croyante, elle aura eu le temps auparavant de mettre la dernière main à ses trois puissants Psaumes en français pour solistes, chœur et orchestre.
Lili Boulanger nous laisse une cinquantaine d’œuvres dans tous les genres, dont quelques-unes « d’une expression […] qui atteint parfois à un pathétique dont l’école française offre peu d’exemples », écrit Marc Honegger. Peu avant sa mort, elle compose une courte « pièce pour orchestre » intitulée D’un matin de printemps, d’abord conçue pour violon, ou flûte, et piano, et marquée Assez animé. Bien qu’elles ne forment pas un diptyque, elle se présente comme le pendant de D’un soir triste, page composée en même temps et bâtie sur un matériau semblable, mais dans un esprit beaucoup plus sombre.
Harry Halbreich décrit D’un matin de printemps comme « un scherzo à la verve primesautière, à l’orchestration aérée et transparente », comme si la jeune femme avait entrevu ce qu’aurait été pour elle une existence en bonne santé, « mais on y voit surgir au milieu une gradation d’orchestre véhémente qui révèle la douleur sous-jacente à cette sérénité si précaire ». Sur une mélodie dansante à trois temps, émaillée de rythmes pointés et de gammes ascendantes, et dans des couleurs harmoniques modales, les échanges rapides entre bois et entre violons solistes, ponctués par les cuivres, déroulent un tissu aux couleurs chatoyantes, très proche de Debussy. « C’est une expression radieuse, presque impressionniste, de la joie de la nature », conclut Gerald Larner.
© François Filiatrault