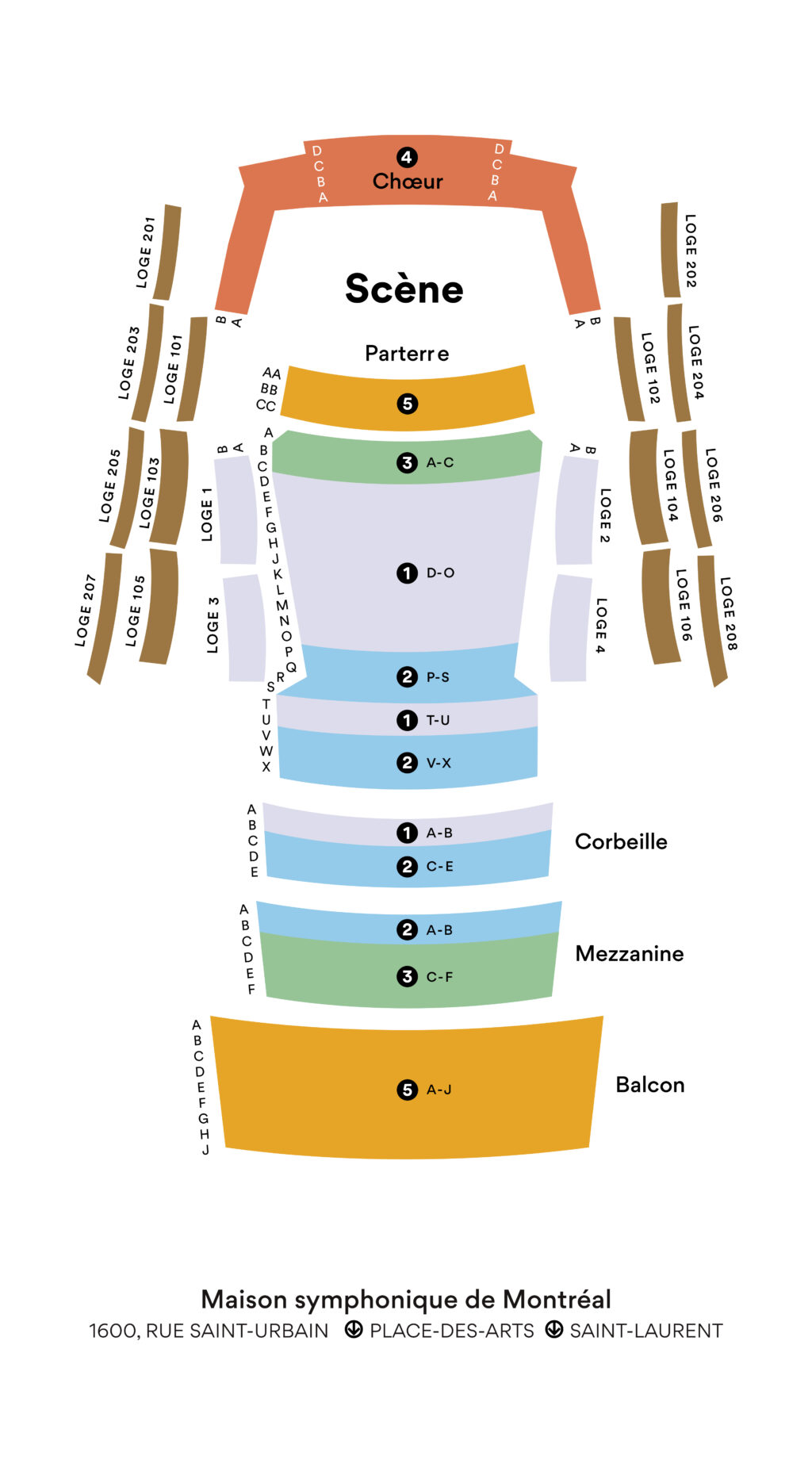Concerto pour violon
Antonín DVOŘÁK
1841-1904
Danses patriotiques
Sans avoir été l’élève de Smetana, Antonín Dvořák a certainement suivi ses traces dans l’affirmation du sentiment national par la musique. Les deux hommes se rencontrent en 1866 alors que Smetana est nommé chef à l’opéra de Prague; Dvořák y est altiste dans l’orchestre et ils deviennent des amis. Attaché aux formes classiques autant qu’au folklore de son pays, il est parmi ceux qui en réussissent le mariage le plus heureux. L’autre grande influence qui se fait sentir chez Dvořák est celle de Johannes Brahms, qui prend le compositeur sous son aile et le présente à son éditeur Simrock de même qu’à plusieurs amis, dont le violoniste Joseph Joachim et le chef d’orchestre Hans von Bülow.
Inspiré par les Danses hongroises de Brahms, Dvořák compose deux séries de Danses slaves en 1878 et 1886. Malgré leur nom, c’est principalement du folklore de Bohême qu’elles s’inspirent. Écrites à l’origine pour piano à quatre mains, ce qui contribua grandement à leur diffusion et à leur popularité, elles sont ensuite orchestrées par le compositeur. La Danse slave en mi mineur, op. 72 no 2, qui prend la forme d’une doumka (complainte slave), est empreinte de lyrisme et de mélancolie, alors que sa partie centrale, plus dansante, respire une fraîcheur printanière.
Un concerto empreint de folklore
C’est en 1879 que Dvořák commence la composition de son Concerto pour violon en la mineur, à l’invitation de son éditeur Simrock, qui voulait profiter du succès remporté par le premier volume des Danses slaves paru l’année précédente. L’œuvre connaît une lente gestation. Souhaitant voir son concerto créé par le grand Joseph Joachim, ami de Brahms, Dvořák consulte l’interprète à plusieurs reprises. Joachim lui suggère plusieurs modifications qui l’amènent, en 1880, à réécrire l’ouvrage. Deux ans passent, au cours desquels le violoniste ne communique pas avec le compositeur et ne démontre aucun intérêt à programmer le concerto en concert. C’est finalement le brillant violoniste František Ondříček qui le créera le 14 octobre 1883 à Prague et qui en donnera également les premières exécutions à Vienne et à Londres.
Marqué Allegro ma non troppo, le premier mouvement débute par une brève et imposante introduction d’orchestre avant que l’instrument soliste énonce un thème lyrique et passionné. Ce dernier sera développé avec beaucoup de fantaisie dans ce mouvement à la forme très libre et au caractère improvisé proche de la rhapsodie. Le mouvement ne comporte pas de conclusion puisqu’il s’enchaîne directement au suivant, un Adagio ma non troppo. Essentiellement mélodique, ce dernier prend la forme d’une romance pleine de noblesse. Une partie centrale en fa mineur donne l’occasion d’un dialogue entre le violon et les cors. Ces derniers réapparaissent à la toute fin du mouvement, lointains, apportant une connotation sylvestre à sa conclusion douce et paisible. C’est sous le signe de la danse qu’est placé le troisième et dernier mouvement, une brillante furiant (danse tchèque à trois temps, proche de la polka) empreinte d’un entrain qui rappelle les Danses slaves. Plus tendre et nostalgique, la partie centrale rappelle quant à elle la doumka, avant le retour du motif principal menant l’œuvre à une conclusion débordante de vie.
© François Zeitouni, 2025