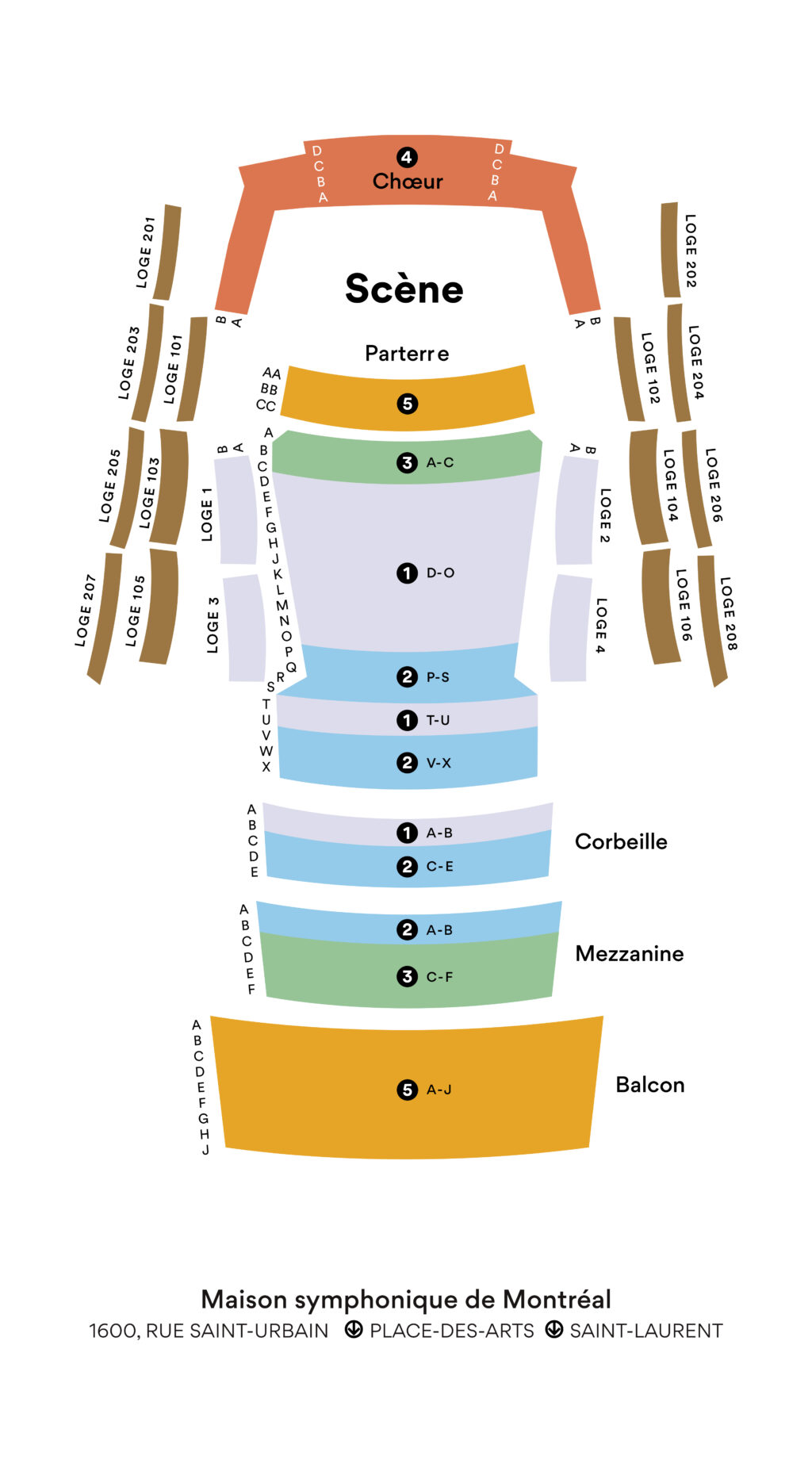Concerto pour orchestre
Bartók
1881 – 1945
Béla Bartók fait partie de ceux qui, comme Stravinsky, se sont exilés aux États-Unis pour fuir la guerre et continuer à exercer librement leur art. En 1943, il écrit un Concerto pour orchestre où il renoue avec ce qui a fait sa réputation de compositeur ethnologue, en quête de thèmes inspirés du folklore musical de la région des Balkans.
L’œuvre s’ouvre sur la répétition d’un thème aux violoncelles, exécuté sur un rythme de plus en plus rapide, tandis que les violons et les flûtes dégagent une atmosphère sonore nébuleuse que l’on peut aisément associer à une musique cinématographique. L’entrée des trompettes donne lieu à un thème secondaire qui, outre sa couleur contrastante, renforce les caractéristiques du premier thème : un style d’écriture modale* à l’ancienne et des reprises en boucle qui évoquent une chanson folklorique. Le retour des violons, secondé par la timbale, ajoute à l’ensemble une tension dramatique. Le foisonnement d’idées musicales est tel qu’une variété d’instruments sont mis en valeur individuellement, qu’il s’agisse d’un cor, d’un trombone ou du hautbois. Dès lors, le principe de concerto pour orchestre prend forme.
Le deuxième mouvement, « Jeu de couples », va plus loin en faisant appel à plusieurs groupes de solistes virtuoses. On entend alternativement cinq paires d’instruments à vents : deux bassons, deux hautbois, deux clarinettes, deux flûtes et deux trompettes avec sourdine.
En guise de troisième mouvement, Bartók compose une élégie, pièce dont le caractère tragique est insufflé ici par le lyrisme des violons et le glas des trompettes. Le prélude, tout comme le postlude, rappellent l’introduction de l’œuvre, imprégnée de mystère.
Le quatrième mouvement s’apparente à une pièce comique, sarcastique, comme on en trouve dans les symphonies sous la forme de scherzos*. Le premier thème est introduit au hautbois sur un rythme irrégulier qui le rend imprévisible et contribue à sa singularité. Inspiré par le style en arabesque cher aux impressionnistes, ce thème se mêle à une mélodie de Franz Lehár, « Da geh’ ich zu Maxim », extraite de son opérette La Veuve joyeuse, que Chostakovitch avait lui aussi citée dans le premier mouvement de sa symphonie » Leningrad « . Il ne peut s’agir là que d’une marque d’ironie adressée à ce compositeur.
Dans le finale, la musique s’anime considérablement par une quantité d’arpèges vigoureux, et une oscillation de crescendos et de decrescendos qui créent des effets de vagues sonores. Des passages de style fugué où plusieurs instruments s’échangent un même motif à tour de rôle témoignent une fois de plus d’un usage respectueux de certaines conventions musicales.
© Justin Bernard