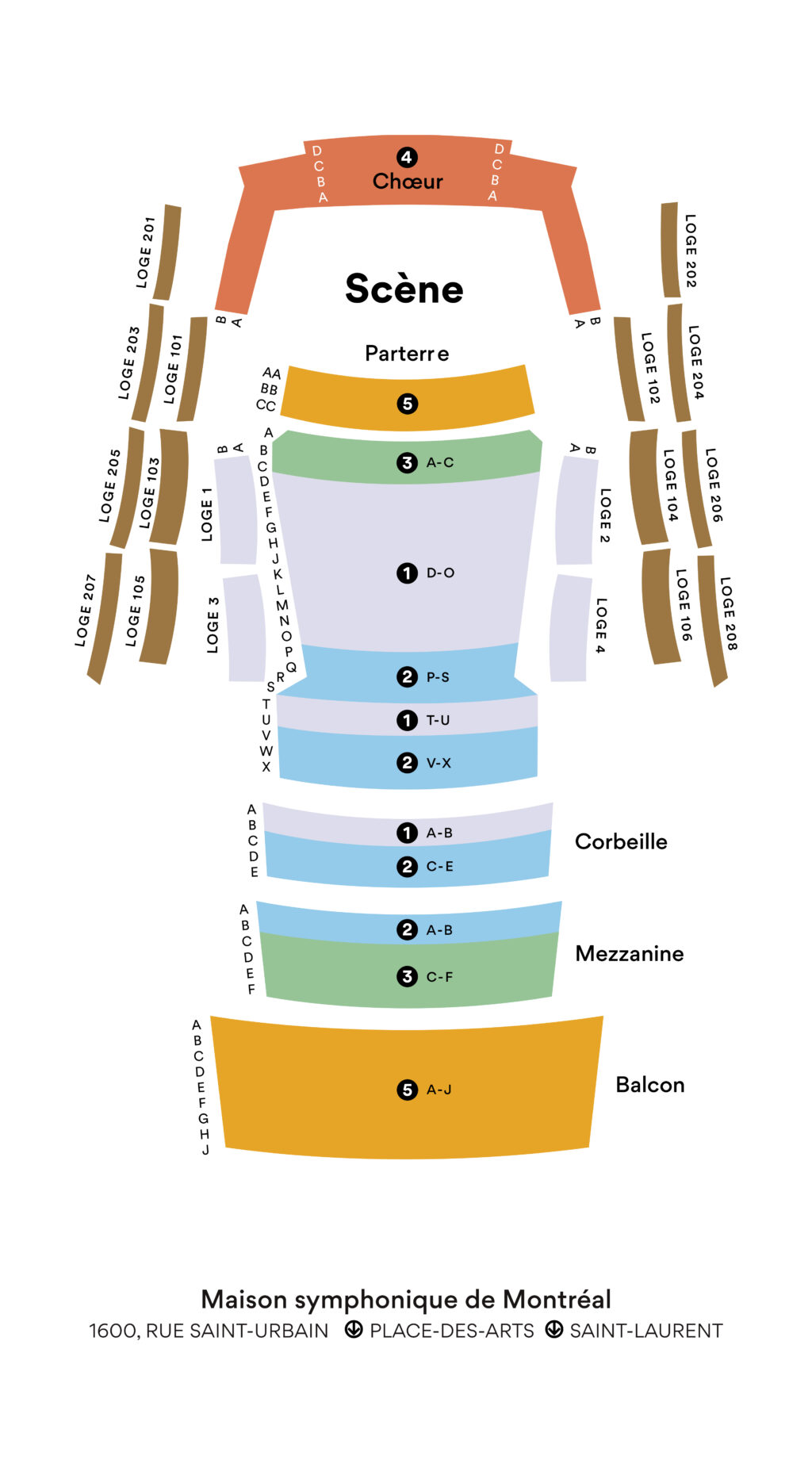Symphonie n° 7
Ludwig Van BEETHOVEN
1770-1827
L’ivresse de la danse
Si la Symphonie no 6 est calme et sereine, la Symphonie no 7 est, à l’opposé, la plus jubilatoire et rythmée des neuf symphonies. Ses premières esquisses témoignent que Beethoven songeait, dès les débuts, à faire du rythme – et non de la mélodie – l’élément central de l’œuvre. En effet, chaque mouvement est dominé par un motif rythmique qui lui donne une couleur particulière. L’euphorie du finale inspirera au compositeur Richard Wagner ces mots célèbres : « La Septième symphonie est l’apothéose de la danse même : c’est la danse à son plus haut degré, le principe même du mouvement corporel incarné dans la musique. »
Après avoir composé six symphonies à un rythme régulier entre 1800 et 1808, Beethoven attend plus de trois ans avant de se lancer dans la composition de sa Symphonie no 7. Le compositeur a néanmoins été productif durant ce hiatus symphonique, autant sur le plan musical que dans sa vie personnelle. En effet, c’est en 1810 qu’il fait la rencontre d’Antonia Brentano, l’une des deux femmes soupçonnées d’être « l’immortelle bien-aimée ».
La Septième est complétée à l’hiver 1812. Malgré sa surdité grandissante, Beethoven refuse de laisser d’autres chefs diriger ses œuvres : c’est donc lui qui est sur le podium lors de la première en décembre 1813. L’ambiance est à la fête et l’orchestre du soir est composé des musiciens les plus célèbres de l’époque: Salieri, Spohr, Moscheles, Hummel, Meyerbeer… Même l’inventeur du métronome, Johann Nepomuk Mälzel, est présent.
« L’interprétation fut absolument magistrale, malgré la direction de Beethoven à la fois confuse et comique, écrit le compositeur et violoniste Louis Spohr. On s’apercevait clairement que le pauvre, presque totalement sourd, n’entendait plus les passages piano de sa propre musique. » Le concert est néanmoins un immense succès et le deuxième mouvement est bissé dans son entièreté.
Tous n’ont pas apprécié, toutefois. On ne peut que sourire en sachant que Friedrich Wieck, le père de Clara Schumann, a fortement critiqué la Septième symphonie, disant n’y entendre que « l’œuvre d’un homme ivre ». Le compositeur Carl Maria von Weber jugea quant à lui qu’après les débordements du dernier mouvement, Beethoven était « mûr pour l’asile », rien de moins.
« Je suis le Bacchus qui vendange le vin dont l’humanité s’enivre … Celui qui a compris ma musique pourra se délivrer des misères où les autres se traînent. »
–Ludwig van Beethoven
La lente introduction Poco sostenuto occupe à elle seule le tiers de la durée du mouvement. Dès les premières mesures du Vivace, la flûte solo entonne le motif rythmique qui sert de fondement au mouvement tout entier. Presque chaque mesure contient le motif, répété de manière inlassable.
Bien qu’il porte l’indication d’Allegretto (« gai » en italien), le second mouvement est une marche funèbre semblable à celle de la symphonie « Héroïque ». Ce sont les cordes graves qui exposent la figure rythmique qui dominera l’ensemble du mouvement : LONG court court / LONG LONG.
Le Presto est un mouvement vif rempli d’entrain et de changements de nuances, dans lequel les timbales s’en donnent à cœur joie. Alors que les trois premiers mouvements sont marqués par des figures rythmiques répétées, l’Allegro con brio final se caractérise quant à lui par une grande diversité de rythmes. Beethoven y exploite toute la puissance de l’orchestre en faisant souvent appel au tutti (quand tous les instruments jouent ensemble). Dès les premières mesures, l’auditeur est entraîné dans un tourbillon d’énergie déchaînée qui ne prendra fin qu’avec la toute dernière note.